Le « cercle d’excellence » est un protocole PNL qui permet d’accumuler de la confiance en mobilisant les ressources nécessaires pour se sentir bien dans un lieu ou une situation que l’on appréhende habituellement.
Vendredi soir. Je sors du bureau. Habituellement je ressens une sorte de libération, une légère euphorie à l’idée de ces deux jours de liberté qui s’ouvrent devant moi. Mais pas aujourd’hui. Je me sens nouée à l’intérieur. Je respire vite, je n’arrive pas à capter les odeurs et les sons autour de moi, ça bourdonne dans ma tête. Avant de partir, j’ai regardé l’agenda de la semaine prochaine : mardi, je dois faire une présentation au CNIT, devant une centaine de personnes. Deux séances consécutives. Deux cents personnes. L’après-midi, à l’heure maudite d’après-déjeuner. Oh, je n’avais pas oublié, ça fait des mois que c’est prévu, des semaines que je prépare mon discours. Mais en voyant ce moment fatidique si proche dans mon agenda, je me suis vraiment sentie mal à l’aise. Je ne parviens plus à réfléchir correctement, mon cerveau n’est fixé que sur ça.
Debout, coincée dans un angle du wagon de métro, j’essaye de penser au week-end. Je vais dîner chez des amis samedi soir. Et dimanche, j’ai prévu de faire un tour au bord de la Marne. Il devrait faire grand soleil. Ces perspectives ne m’enthousiasment pas. Je les vois à travers une sorte de brouillard, un peu comme des trucs irréels. J’ai l’impression que tant qu’on ne sera pas mardi soir, je ne pourrai plus sourire, plus rêver, plus profiter de rien. Pourtant j’ai bien préparé. Je connais à peu près le sujet. Mais j’ai beau me dire ça, c’est plus fort que moi, quand j’y pense, ma gorge se noue, mon ventre me fait mal, ma vue se brouille. Je sens la sueur perler à mes tempes, mes mains devenir moites et mes pieds geler dans mes chaussures fourrées. Je ne vais jamais y arriver. Mardi me paraît à la fois proche et loin. Proche parce qu’il occupe tout mon esprit, loin parce que j’ai l’impression de ce ne sera jamais fini. L’échéance se dresse comme un mur devant moi, un mur qui occulte la suite du chemin, au point que je ne vois même pas s’il y a une vie derrière, s’il y a d’autres week-ends, des vacances, des sourires, des cris de joie.
Je sors du métro. Il pleut. Je ne m’en étais même pas rendu compte. De toute façon, à quoi servirait le soleil ? Je remercie presque le temps de se mettre au diapason de mon humeur. Me voilà devant chez mon coach. J’hésite à sonner. Personne ne peut rien pour moi. Ma tête pèse vers l’avant, comme si je tendais le cou pour simplifier le boulot de l’employé de l’abattoir… La pluie redouble. Allez, je rentre. Maintenant que je suis là…
*
Poignée de main. Echanges autour de la pluie qui bat les fenêtres de la salle un peu froide où les néons engagent un bras de fer avec l’obscurité qui tente d’envahir l’espace. Sombre, blafard, froid, les mots qui dansent dans ma tête ont tous cette coloration sinistre. J’expose mon objectif du jour. Ne pas avoir peur pour cette présentation mardi. Non, c’est négatif. Être moins mal à l’aise devant un public. Pas très positif non plus. Être détendue et en pleine possession de mes moyens mardi. Oui, ça ne dépend que de moi, non ça ne nuira à personne, oui je saurai le mesurer à mon niveau de stress sur une échelle de 1 à 10, oui, j’aurai un réel intérêt à atteindre cet objectif, je serai plus efficace, mon message passera mieux, je maîtriserai la situation. De quoi aurais-je besoin pour être détendue et en pleine possession de mes moyens mardi ? Voyons… Que ce soit annulé… Non, ce n’est pas possible… Que quelqu’un d’autre le fasse à ma place… Pas possible non plus… J’aurais besoin d’avoir davantage de confiance en moi.
Je me tiens debout au milieu de la pièce. Je ferme les yeux. J’imagine devant moi un cercle. Il fait un peu moins d’un mètre de diamètre. Il est violet, recouvert de paillettes dorées qui le font scintiller. Il dégage une lumière qui pulse lentement, comme si un cœur battait à l’intérieur. Il est en légère en lévitation, flottant à quelques centimètres du sol. Son image est imprimée sur mes paupières closes. Je le sens, là, juste devant moi.
Je fais un pas en avant. Me voilà dans le cercle. Je sens sa légère chaleur autour de moi et la lumière filtre doucement à travers mes paupières fermées. Je laisse venir un moment du passé où j’ai ressenti de la confiance en moi. Ce n’est pas évident. Plusieurs épisodes du même ordre que celui qui m’attend mardi se présentent dans le champ de ma conscience. Cette présentation à l’auditorium. Une bonne centaine de personnes. Certaines dormaient dans les fauteuils confortables. Non, pas de confiance. Un rendez-vous pour un entretien d’embauche passe fugitivement devant mes yeux. Pas de confiance non plus. J’inspire un grand coup. Je vide mes poumons longuement pour chasser ces souvenirs et faire la place à celui que je cherche, à celui qui sera ma ressource…
Je sens une texture souple et douce sous mes mains. Un peu fraîche. Légèrement farineuse. De la pâte sablée. Je la dépose dans le fond d’un moule, je la lisse pour qu’elle soit bien plate, j’appuie les bords contre le moule. Puis je sens une spatule dans ma main droite. Je mélange du beurre et du sucre, d’un geste ample. J’ajoute des œufs. Je suis sûre de moi. Je ne me pose pas de question. Je tourne. J’ajoute ensuite de la poudre l’amandes. Mon esprit s’envole vers les amandiers en fleurs, puis je ressens sur ma langue la fraîcheur, le goût fin et doux, la légère note d’humidité, comme une goutte de rosée du matin qui explose, des amandes que l’on croque juste après les avoir cueillies sur l’arbre. Le velouté de leur coque aussi. Son vert tendre et soyeux. Je mélange tandis qu’un feu doux réchauffe l’ensemble, ses flammes aux couleurs changeantes dansant doucement sous la casserole. Le chuchotement du gaz parvient à mon oreille, un délicieux fumet commence à envahir la cuisine, une chaleur légère monte de la casserole et colore insensiblement mes joues. Je suis tranquille. Je sais que je vais y arriver. Je n’ai aucun doute. J’étale la frangipane sur la pâte, doucement, en l’égalisant bien. Je racle les bords de la casserole et je suce mes doigts, un goût sucré et régressif envahit ma bouche. Délicatement je pose des demi-poires sur la crème. En rond, plus une au milieu. Je regarde la jolie rosace. C’est le dessert préféré de ma fille, elle va être heureuse, je vais regarder ses yeux briller, je n’en doute pas un instant. J’ai confiance en moi. A ce moment précis où je ressens pleinement ce sentiment, je touche mon poignet gauche de ma main droite. Ce sera mon ancre de confiance en moi.
Un pas en arrière, je sors du cercle. Je m’ébroue un peu. La cuisine se dissout, la pièce froide et sombre reprend ses droits, mais les néons semblent distiller un peu plus de chaleur. Je regarde dehors. Une petite pluie tombe encore et fait des stries devant les réverbères.
Je regarde mon cercle, violet, scintillant, palpitant. J’entre de nouveau à l’intérieur. Je laisse venir un autre souvenir lié à la confiance en soi. Je marche sur un sol caillouteux. Mes semelles sont épaisses, mais je sens quand même les reliefs du chemin. C’est un chemin étroit. Je franchis des traverses de chemin de fer posées perpendiculairement au passage, assez espacées, au-dessus d’un trou creusé profondément dans la terre aride. Un stratagème visant à empêcher les moutons de s’égayer en dehors de leur espace… Le sentier commence à monter. Des feuilles de fougère empiètent sur les côtés. Les arbres se font plus touffus à mesure que j’avance. L’inclinaison s’accentue. J’appuie sur mes cuisses. Mon souffle se raccourcit à chaque pas. Je sens mes joues s’échauffer, quelques gouttes de sueur glisser le long de ma colonne vertébrale. En haut du raidillon je m’arrête. Je sors une bouteille de mon sac et je savoure la fraîcheur de l’eau qui coule dans ma gorge. Mon cœur ralentit, mon souffle s’allonge. Je sens l’odeur des feuilles. Ici à l’ombre, un peu de mousse adoucit les contours des pierres posées ça et là. J’entends le chant d’un oiseau. Puis le frémissement d’un ruisseau. Je sais où je vais. Je sais que le chemin va redescendre, que juste derrière un mouvement vers la droite un énorme rocher couvert de lichen me regardera, posé là dans un équilibre improbable. Je m’arrête au bord du ruisseau. Je jette quelques cailloux, j’écoute leur « pop » quand ils crèvent la surface de l’eau, je regarde les cercles concentriques se propager jusqu’à embrasser la berge. Le chemin s’étrécit et devient tortueux. Je tends la main et cueille une mûre. Ses grains explosent dans ma bouche, libérant leur jus sucré et chaud malgré la pénombre fraîche qui règne dans le sous-bois. J’avance encore. Aucun doute, je connais la voie. Je me sens bien, serine, complète. Soudain je la vois. Là, devant moi, séculaire : la borne n°23 marquant la frontière entre la France et l’Espagne. Tant de fois j’y ai posé la main, tant de fois j’ai posé un pied de part et d’autre en riant de l’étrangeté d’avoir le pied gauche ibérique et le pied droit gaulois. J’y pose encore une fois la paume. Je sens la sagesse des ans m’envahir à travers les aspérités du granit. Je me repose un moment. Encore quelques centaines de mètres tout contre le lit du ruisseau charriant de la terre rouge et je m’assieds sur un banc de bois posé sous des platanes étrangement plantés en carré au milieu d’une forêt de chênes et de hêtres. L’homme s’approche et pose devant moi une tranche de fromage de brebis et de la confiture de cerises noires. J’ai atteint mon but. L’air est léger. Je suis bien. Je suis moi. Une fois encore je touche mon poignet gauche avec ma main droite en goûtant ce plein moment de confiance et de sérénité.
Un pas en arrière. Je quitte la montagne basque et reviens dans la salle. Je secoue mes jambes et mes bras. Le chant du ruisseau s’éloigne, l’odeur des bois est remplacée par celle du café froid qui doit traîner dans un coin. Je regarde dehors. La pluie a cessé. Les grands marronniers s’égouttent sur les grilles noires qui enserrent leurs pieds.
Je pense à la présentation de mardi et à son sujet sexy, « supervision métier et banque digitale ». Je fais un pas en avant. La puissance de mon cercle m’enveloppe. Sa lumière chaude m’envahit. Je suis dans une grande salle, au sous-sol du CNIT. Des personnes entrent et s’assoient. Certaines posent un cahier sur leurs genoux. Je suis assise devant un bureau, sur une estrade. J’inspire. Je pose ma main droite sur mon poignet gauche. Je ressens un grand calme intérieur. Mes pieds sont posés à plat sur le sol, je me sens reliée à la terre, ancrée dans le présent, droite. Le silence se fait. Je prends la parole. Je déroule mon exposé, en y glissant de temps à autre quelques anecdotes amusantes qui font rire l’auditoire. Les mots s’enchainent, ils coulent comme le ruisseau au bord du chemin, dansent sans trébucher, voyagent entre les murs de la pièce doucement éclairée. Je vois des personnes debout au fond. Elles n’ont pas pu trouver de siège. Trop de monde. Je leur souris et continue à parler. Une personne se lève et me pose une question. Je me sens parfaitement détendue, l’esprit clair. La réponse vient spontanément. Je connais le sujet. Plus de questions. Je clos la séance. A ma grande surprise, des applaudissements s’élèvent. Je remercie l’assemblée. Je remets en ordre mes papiers. Allez, une petite pause avant d’attaquer la deuxième séance.
*
Un pas en arrière. Je sors du cercle. Je l’emmène avec moi et descends dans la rue. Le ciel est clair maintenant. Je vois briller quelques étoiles. Je marche tranquillement vers le week-end. Je commence à savourer le samedi soir entre amis, le soleil du dimanche réchauffe déjà mes os. Soudain, au coin de la rue, trois jeunes hommes surgissent devant moi. Je sursaute. Dans la lumière crépusculaire, ils me paraissent immenses. Le plus grand fait encore un pas en avant, me dominant de plus d’une tête. « Hé, m’dame ? ». Je lance mon cercle devant moi, je saute dedans. J’inspire. Je pose ma main droite sur mon poignet gauche. J’expire. « Oui ? ». Il avance encore. Je penche la tête pour le regarder dans les yeux. Je souris. Tranquille. « Vous sauriez où est la place Félix Éboué ? ». Bien sûr je sais. Droite, gauche, tout droit. Simple. « Merci ». Je remets mon cercle sur mon épaule, et m’éloigne vers le métro en saluant les trois compères de la main.
© Copyright Isabelle Anne Roche – 2017 – Tous droits réservés
Le texte de cet article est la propriété de son auteur et ne peut être utilisé sans son accord et sous certaines conditions.
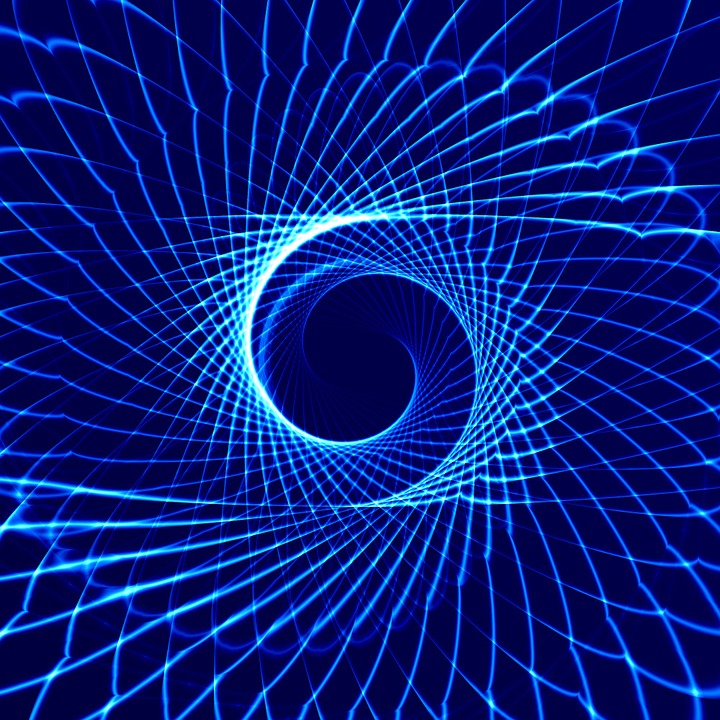


Je découvre tes textes…Superbes…Tu écris très bien bravo!
Merci Rairaine !!! Venant de plus du fleuron de l’éducation nationale, je suis flattée… Bonne journée et gros bisous !
Merci beaucoup Mme pour ce texte très édifiant. Je souhaite apprendre davantage auprès de votre grande expertise.
Merci beaucoup pour votre commentaire. J’espère vous transmettre un peu de ce que j’ai pu apprendre au travers d’autres textes bientôt. Vous m’encouragez, merci encore !